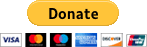Les étés 2016 et 2017 ont scellé une rupture initiée de longue date dans les mouvements antiracistes français, entre défenseurs d’un universalisme républicain d’un côté, et partisans d’un multiculturalisme à l’anglo-saxonne de l’autre. Deux polémiques vont finir par définitivement polariser les associations, avec des conséquences bien plus importantes que la division qui existait déjà au sujet des pratiques de discrimination positive. Tout d’abord, il y a l’organisation d’un « camp d’été décolonial » en août 2016 par deux militantes antiracistes. Au programme, des formations, ateliers et tables rondes conçues afin de "construire des résistances", allant de la "lutte anti-négrophobie" au "féminisme décolonial" en passant par la désobéissance civile. Ensuite, il y aura Nyansapo, le premier festival afroféministe européen organisé par le collectif Mwasi au mois de juillet 2017, que la maire de Paris Anna Hidalgo avait d’abord tenté d’interdire avant de finalement trouver un compromis avec La Générale, la coopérative qui prêtait ses locaux pour l’occasion.
Le point commun entre ces événements, outre le fait d’être tous deux portés par des militantes antiracistes, c’est la mise en œuvre de la non-mixité comme outil d’émancipation et d’éducation populaire. Ce choix polémique va opposer les organisations historiques telles que SOS Racisme, la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) et le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), à des mouvements plus jeunes comme le CRAN (Conseil représentatif des associations noires de France), LIR (Les Indigènes de la République), ou le Collectif contre l’Islamophobie en France. Face au tollé, il était alors devenu indispensable pour les militants d’expliquer le principe et la raison d’être de la non-mixité, une pratique née au sein des mouvements féministes américains dans les années 1970, mais que certains ont découvert avec la médiatisation de ces évènements inédits en France. La non-mixité, concrètement, c’est le fait de créer des espaces de théorisation et de réflexion sur une forme d’oppression particulière, ouverts uniquement aux personnes qui la subissent. Pour les mouvements antiracistes et féministes qui la pratiquent, le choix de la non-mixité repose sur deux présupposés très simples.
Le premier correspond au constat qu’il existe des rapports de domination sociale et des discriminations systémiques, c’est-à-dire la prise de conscience du fait que les discriminations sont produites par une majorité qui impose son pouvoir et ses propres privilèges sur les autres groupes, grâce à des moyens politiques, économiques et institutionnels[i]. Le second affirme que dans les groupes mixtes, ces rapports de domination, qui sont censés être déconstruits et combattus au sein du groupe, sont au contraire reproduits à travers des mécanismes inconscients, qui poussent les individus appartenant au groupe dominant à monopoliser la parole et à imposer leurs vues. Ainsi, se référant à la lutte des Noir.e.s pour leurs droits civiques aux Etats-Unis dans les années 1960, Christine Delphy fait l’analyse suivante : « On faisait semblant […] que la situation où les Blancs étaient oppresseurs et les Noirs opprimés était sans influence sur le fonctionnement des groupes de droits civiques : 1) sur leur politique : 2) sur la structure de pouvoir de ces groupes. On faisait comme si l’inégalité intrinsèque caractérisant les rapports entre Noirs et Blancs était annulée dès qu’on entrait dans le local de l’organisation » [ii].
Mais revenons un instant sur le premier principe. L’idée selon laquelle il existe un « racisme systémique » ou « racisme institutionnel » a été conceptualisée aux Etats-Unis en 1967 par les militants Stokely Carmichael et Charles V. Hamilton. Partant du constat de la persistance d’un racisme plus subtil malgré l’abolition de la ségrégation, Carmichael et Hamilton définissent ce concept comme « l'incapacité collective d'une organisation à procurer un service approprié et professionnel à des individus en raison de leur couleur de peau, de leur culture ou de leur origine ethnique »[iii]. Ils le distinguent du « racisme d’état » tel qu’il était appliqué aux Etats-Unis et en Afrique du Sud durant leurs périodes ségrégationnistes, dans le sens où, alors que la ségrégation raciale affichait une idéologie officielle explicitement raciste, le racisme institutionnel est lui beaucoup plus subtil. Par ailleurs, ce phénomène ne s’exprime pas selon les mêmes modalités que le racisme individuel, car il « trouve son origine dans l'action de forces établies et respectées de la société, et reçoit par conséquent bien moins de critique publique ».
Dans ses travaux sur le logement social en France, la sociologue Valérie Sala Pala[iv], définit la notion de racisme institutionnel comme « production institutionnelle de frontières ethniques », qui opère « en dehors de toute intention manifeste et directe de nuire à certains groupes ethniques », et dont le résultat est l’exclusion et l’infériorisation de certains groupes, à travers le développement de certaines pratiques par les institutions ou les acteurs qui en font partie. Il ne s’agit donc plus de combattre des comportements racistes individuels que la morale réprouverait, mais d’élever la lutte au niveau politique.
Qu’en est-il de la situation au Luxembourg ? La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a sorti son cinquième rapport sur le Luxembourg en février 2018[v]. Cet organe indépendant de monitoring dans le domaine des droits de l’homme, spécialisé dans les questions de lutte contre le racisme et l’intolérance, constitue le baromètre principal pour ce qui est du racisme et de l’intolérance en Europe. Dans son rapport, même s’il ne mentionne pas le terme de racisme institutionnel, l’ECRI met en lumière la montée d’un discours raciste et islamophobe, et fait état de plusieurs domaines pour lesquels il engage les autorités luxembourgeoises à « élimer toute discrimination structurelle subsistante ». Le premier de ces domaines est celui de l’accès à l’emploi.
Au Luxembourg, 75% des emplois peu qualifiés sont occupés par des personnes issues de l’immigration. Et si le taux de pauvreté est six fois plus élevé parmi les ressortissants des pays tiers que parmi les nationaux, les populations qui rencontrent le plus de problèmes sur le marché du travail sont les ressortissants du Cap-Vert, les demandeurs de protection internationale et les musulmans. Une étude du CEFIS sur la communauté capverdienne au Luxembourg[vi] montre même que le taux de chômage chez les capverdiens, d’environ 19%, atteint le triple de la moyenne nationale qui est de 7%. Un autre domaine concerne l’inégalité de traitement subie par la communauté musulmane face aux autorités, que ces dernières expliquent par le délai de deux ans nécessaire pour débloquer le financement prévu par la convention signée avec l’Etat. Dans son rapport, l’ECRI mentionne nottamment l’assujettissement à la taxation imposée à plusieurs associations musulmanes, les nombreux problèmes rencontrés lors des projets de construction et de rénovation de mosquées, ainsi que l’absence d’aménagements appropriés pour les obsèques musulmanes.
Mais l’aspect le plus préoccupant concerne la scolarisation des enfants. Le rapport de l’ECRI, dont l’enquête a été réalisée entre novembre 2012 et juin 2016, soulève l’existence de discriminations structurelles dans l’éducation. L’étude du CEFIS sur la diaspora capverdienne, va plus loin en soulignant l’ampleur de ces discriminations s’agissant de cette communauté. En effet, parmi toutes les communautés les plus importantes sur le territoire, les enfants capverdiens sont de loin ceux qui redoublent le plus souvent une classe. Un échec scolaire que le CEFIS lie aux conditions sociales vécues par les parents immigrés, notamment sur le marché de l’emploi et du logement. L’étude pointe également le sentiment de discrimination et d’injustice ressenti par certains parents concernant l’orientation scolaire de leurs enfants, qui « qualifient cette discrimination de « soft », dans le sens où le racisme n’est pas exprimé ouvertement, mais il s’agit, selon eux, plutôt de discriminations indirectes, voire inconscientes, dictées par le système ». Les décisions prises par les enseignants, qui ont tendance à orienter les élèves capverdiens vers le modulaire, contribuent à « une rapide ethnicisation des rapports sociaux dans le champ scolaire », une situation ayant pour base « les préjugés véhiculés au Luxembourg à propos des capverdiens ».
La situation démographique particulière du Luxembourg, avec 47% de non-luxembourgeois résidents, ainsi que 180 000 travailleurs frontaliers français, allemands et belges également visés par xénophobie[vii], a tendance à diluer les discriminations subies par les minorités visibles. Pourtant, le discours de haine autour duquel la parole s’est libérée et qui s’est amplifié depuis le référendum sur le droit de vote des étrangers en 2015, vise principalement les réfugiés et les minorités visibles. Par ailleurs, parmi les jeunes issus de l’immigration, très peu disent avoir déjà été victimes de discriminations, alors que 11% des personnes issues de l’immigration extra-communautaire se perçoivent comme appartenant à un groupe discriminé[viii]. Enfin, le sondage réalisé par TNS-ILRES pour le CET en 2015[ix], montre que le pourcentage des discriminations relatives à la couleur de peau est plus élevé que tous les autres motifs (14%).
Tous ces éléments font relativiser l’impact de la législation anti-discrimination et des campagnes de sensibilisation sur le racisme, au Luxembourg tout comme dans les pays voisins. Face à ce constat, et afin que la lutte pour l’égalité devienne réellement un thème transversal à toutes les autres questions qui concernent la cité, il est temps d’envisager un autre mode d’action. Une action qui se situerait sur le plan politique, tout comme l’est devenue la cause écologiste dans les années 1970, lorsque les travaux scientifiques sur l’impact de l’industrialisation sur l’environnement ont peu à peu engendrés une réflexion politique, suscitant une prise de conscience de la société civile.
[i] SIMON Patrick (2005), Le rôle des statistiques dans la transformation du système de discrimination, http://seminaire.samizdat.net/IMG/pdf/Patrick_Simon_2.pdf.
[ii] DELPHY Christine ([1977] 1998). « Nos amis et nous ». In L’ennemi principal, tome 1 (pp. 167-215). Paris : Syllepse.
[iii] CARMICHAEL, S., HAMILTON, C. V., PIDOUX, O., & BOURCIER, M.-H. (2009). Le Black Power pour une politique de libération aux États-Unis. Paris, Payot & Rivages.
[iv] SALA PALA, Valérie, “Le racisme institutionnel dans la politique du logement social”, Sciences de la Société, n° 65, mai 2005, pp. 87-102 (voir p. 88).
[v] Commission européenne contre le racisme et l’intolérance ECRI, Cinquième rapport sur le Luxembourg, Strasbourg, 2017.
[vi] JACOBS, A., MANÇO, A., MERTZ, F. (2007), “Diaspora capverdienne au Luxembourg”, RED, n° 21.
[vii] Centre pour l’Egalité de Traitement, Observatoire des discriminations 2015, Luxembourg, (http://cet.lu/wp-content/uploads/2015/07/TNS-ILRES-version-impression.pdf
[viii] L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2015), Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2015
[ix] Centre pour l’Egalité de Traitement, Observatoire des discriminations 2015, Luxembourg, (http://cet.lu/wp-content/uploads/2015/07/TNS-ILRES-version-impression.pdf